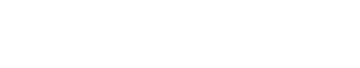« On était en janvier et il faisait moins 40, se souvient la Dre Akila Whiley qui relate son arrivée dans la petite ville de Red Lake, à environ 500 km au nord-ouest de Thunder Bay. C’était une nuit noire. Je ne savais pas où j’étais. La personne qui dégage la piste m’a conduite chez moi… Je n’avais pas mes bagages. »
« C’était tout simplement fou! »
La Dre Whiley est originaire de Halifax. Après son baccalauréat à la McGill University à Montréal, elle est retournée dans sa ville pour étudier à l’école de médecine de Dalhousie puis a obtenu une place en résidence en médecine familiale à l’University of Toronto. Jusqu’à ce moment-là, selon son expérience dans de grands centres urbains uniquement, l’accent semblait être sur les spécialisations, n’importe quoi sauf le généralisme rural et la médecine familiale.
« Ce n’était pas réellement ce que je voulais, dit-elle au sujet de ses options pour sa dernière année de résidence. Alors j’ai honnêtement dressé la carte des endroits où je pourrais aller… et j’ai choisi le lieu le plus éloigné sur la carte. »
C’était Red Lake, et elle dit qu’au début de sa résidence là-bas « il m’a fallu être très brave. C’était réellement effrayant. » Mais elle a dû se montrer courageuse car elle a fait très bonne impression. Le dernier jour, un médecin local lui a demandé de revenir exercer à Red Lake.
« Je n’y avais pas pensé. J’ai pris l’avion et suis partie. C’est alors que j’ai eu le sentiment horrible que je ne reviendrai jamais. Ce fut mon signe. »
« J’ai écrit au médecin une semaine plus tard pour lui dire… j’embarque. »
Quatre mois plus tard, elle était de nouveau dans l’avion pour Red Lake.
« On se lance, c’est tout, dit-elle au sujet de son installation à Red Lake. On le sait immédiatement. Je savais que je voulais aller à Red Lake, mais en y repensant, il fallait du courage. »
Au cours de sa première année dans la communauté, malgré une pointe de « syndrome de l’imposteur », elle savait qu’elle était bien formée pour être une bonne généraliste rurale et médecin de famille. Elle savait aussi qu’elle n’était pas seule : « Dans les communautés comme la nôtre, j’ai toujours eu le sentiment que quelqu’un était prêt à m’aider au besoin ».
Et elle a eu besoin d’aide. En effet, au cours de ses trois premières semaines en fonction, il a fallu évacuer complètement l’hôpital de Red Lake à cause des incendies de forêts menaçants.
« On peut se préparer pour plusieurs choses, dit-elle de son expérience surréelle. Mais il y a aussi celles qui demandent du courage, du leadership, un engagement envers la communauté et les ressources sûres dont on dispose à titre de clinicien. »
Chaque patient a été évacué en toute sécurité, et la Dre Whiley voit maintenant combien cet événement effrayant a galvanisé la communauté encore plus : « Ce fut un effort collectif remarquable. Je vois beaucoup de gens, et ils me rappellent que nous sommes liés car nous avons traversé cette expérience ensemble ».
La population de Red Lake l’appuie et l’estime : « Je sens que je suis très bienvenue et que mon travail est apprécié. Vous savez, c’est spécial de servir une petite communauté unique et unie. C’est un sentiment difficile à décrire. On se soucie sincèrement des gens à tous les stades de leur vie. Je me réalise pleinement ».
Cet entretien devant un feu de camp a été possible grâce à la généreuse commandite de Weaver Simmons.