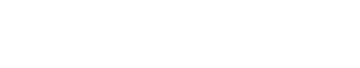Le Dr Lloyd Douglas était engagé dans la santé publique avant même d’en avoir conscience.
« À la Jamaïque, quand j’avais une vingtaine d’années, ma communauté rurale était menacée par des ouragans, et j’étais le gars qui courait partout pour mettre les gens en sécurité ».
Ce qui a commencé par du bénévolat est devenu une véritable expérience de santé publique quand le Dr Douglas a participé la planification des urgences et à l’intervention pendant la saison des ouragans sur son île. Cette expérience l’a conduit à devenir médecin.
« J’ai toujours eu cette passion et j’ai toujours voulu apporter de l’aide. »
Passons maintenant à avril 2019 où le Dr Douglas a été le seul résident en médecine au Canada à recevoir le tout premier Prix Dr Ian Bowman pour le leadership en matière de responsabilité sociale, présenté au nom du Conseil médical du Canada, un honneur qu’il a gagné au fil de son parcours.
Le Dr Douglas, qui a effectué ses études de médecine à la Jamaïque, a immigré à Ottawa avec sa femme et son jeune fils en 2010; sa fille est née plus tard cette année-là à Ottawa. Le plan était d’effectuer sa résidence en médecine au Canada. Il dit qu’il avait presque renoncé à essayer de s’inscrire à un programme jusqu’à ce qu’il déménage à Sioux Lookout pour faire du bénévolat et décide de présenter une demande d’admission à l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) dans l’intention de servir les communautés autochtones dans le Nord.
« J’ai réalisé que je pouvais aider à combler les lacunes dans le Nord. Alors je suis venu à l’EMNO et dans le Nord avec l’intention claire de travailler avec les communautés des Premières nations. J’ai commencé ma résidence en santé publique et médecine préventive en 2014 et avec la permission de l’EMNO, j’ai demandé un transfert pour le dernier mois de mon stage de résidence afin d’aider les évacués, à titre d’agent de sécurité du centre des opérations d’urgence de l’Independent First Nations Alliance (IFNA) à Sioux Lookout.
Dans cet esprit, le Dr Douglas continue de travailler à Sioux Lookout. Lorsqu’il s’est joint à l’EMNO, il a expressément demandé de se rendre à Sioux Lookout pour terminer son stage en milieu rural. Cette ville se trouve à 398 kilomètres de route, au nord-ouest de Thunder Bay et est considérée comme une plaque tournante pour le grand nord. Elle dessert jusqu’à 33 Premières Nations. Six ans plus tard, il y vit encore et a l’intention d’y rester : « La venue dans le Nord n’offrait aucune sécurité mais je serais venu même si c’était seulement pour faire du bénévolat ».
« Je vais là où on a besoin de moi. Il ne s’agit pas de moi, il s’agit de faire partie de la solution pour redonner du pouvoir aux communautés autochtones. Je ne joue qu’un rôle de soutien, explique-t-il métaphoriquement. Je tiens le micro pendant qu’elles parlent ».
Le Dr Douglas joue ce rôle de soutien depuis son enfance. Sa passion personnelle pour aider les gens est née lorsqu’il a vu son grand-père surmonter un grave problème de consommation d’alcool et appris que son père s’était remis d’une dépendance au jeu. Il pense que son bénévolat à l’Église adventiste du septième jour en Jamaïque lui a instillé sa passion pour la santé publique.
Cette expérience l’a amené à son travail d’aujourd’hui, à aider à faire face à la crise régionale des opioïdes. Il a été le premier médecin de la région à utiliser la naltrexone pour traiter les troubles graves liés à l’alcoolisme dans le cadre du programme Accès spécial aux médicaments et aux produits de santé de Santé Canada.
Dans deux collectivités autochtones éloignées accessibles par air seulement, il a établi des relations de travail avec les dirigeants communautaires. À leur demande, il a aidé à monter le dossier pour l’établissement d’un centre de traitement et à trouver des commandites d’organismes pour des ateliers sur le diabète. Il a également travaillé avec la direction et le personnel infirmier du Service de soutien au sevrage des patients externes du SLMHC afin de rétablir un service médical de lutte contre a toxicomanie afin de faciliter le traitement des troubles liés à l’usage de substances chez les clients des collectivités autochtones éloignées et à Sioux Lookout.
Il a établi des liens personnels avec la communauté. Il appelle affectueusement ses amis et ses voisins ses « frères et sœurs autochtones ». Il dit que sa foi offre aussi un lien unique avec la communauté : « Moi aussi, je crois au Créateur et à la puissance supérieure, et je ne crois pas que je suis ici par hasard. Je crois qu’il y a une raison pour laquelle j’ai atterri ici. »
Il encourage les autres, les étudiants en médecine, les résidents en médecine et les « autres cercles », à réfléchir à la façon dont ils peuvent eux aussi contribuer à un changement concret et utile.
« J’espère voir les gens sortir des sentiers battus et agit… Il faut établir des relations, décoloniser, redonner du pouvoir aux gens, se réconcilier… toutes ces choses sont importantes et pour que cela fonctionne, il faut que chaque résident vienne passer du temps dans les communautés et prenne le temps d’écouter les gens. Nous devons vraiment sortir de notre coquille, nous impliquer et nous éloigner de l’individualisme. Il faut penser aux autres. »
À propos du Prix Dr Ian Bowmer pour le leadership en responsabilité sociale
Ce prix national est décerné par le Conseil médical du Canada à un seul étudiant en médecine et à un seul résident au Canada qui ont fait preuve de leadership en matière de responsabilité sociale au sein des facultés de médecine du pays. L’accent est mis sur les leaders qui ont conçu de nouvelles approches et inspiré les équipes à répondre aux besoins d’une communauté ou d’une population en élaborant en consultation et en collaboration une approche et une vision pertinentes en partenariat avec les communautés.
Le Dr Douglas est un résident postdoctoral en cinquième année en médecine du Programme de santé publique et de médecine préventive (PSMP) qui démontre un engagement continu envers la responsabilité sociale et les populations insuffisamment desservies du Nord de l’Ontario. Plus précisément, il a contribué à améliorer l’accès des Autochtones aux soins à partir de sa base à Sioux Lookout, en Ontario.